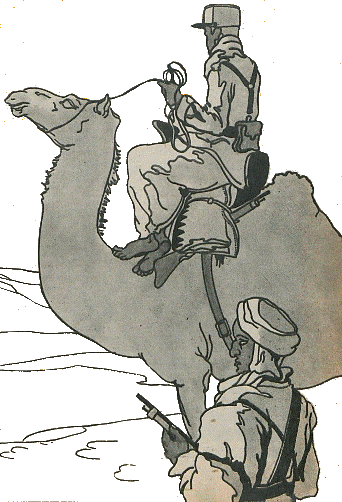LA
COMPAGNIE DES AJJER
Nouvelle inédite de Joseph PEYRÉ (1892-1968)

Marche - Le Magazine Français n° 7 du 10 février 1942
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

LA
COMPAGNIE DES AJJER
Nouvelle inédite de Joseph PEYRÉ (1892-1968)

Marche - Le Magazine Français n° 7 du 10 février 1942
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le chef de poste de Fort-Saint tâchait de ne pas accuser le coup. Amour-propre de corps le goum sud-tunisien ne devait pas plier devant la Saharienne. Mais la « visite » que venait de lui faire, en voisin, le maréchal des logis Ledormeur, de la compagnie des Ajjer, l’avait sonné.
On était au 10 août, le mois de la mort saharienne. La porte de Fort-Saint, sentinelle avancée des bordjs sud-tunisiens, ouverte sur un sable à griller vif celui qui y serait tombé d’insolation, soufflait l’haleine des démons. En août, l’homme n’a qu’à souffrir, attaché à ses murs. À l’ombre du rempart, torse nu, on brûlait de la nuque aux reins, sous le ruissellement de fièvre de la sueur. Les mouches plates collaient derrière les oreilles, comme au poil d’un cheval mouillé. Et, si la main n’avait plus eu de vie, elles auraient niché au coin des yeux leur vermine.
Cependant Ledormeur parlait de repartir.
Les fous, on les enferme. Or le maréchal- des logis Ledormeur avait la folie de la « compagnie », compagnie des Ajjer, l’authentique compagnie du désert de l’est et des Tassilis, comme celle des Hoggar l’était de la montagne de l’Ilamane. Que lui chantait-on de compagnies portées ou de la compagnie. de Tinghert ! Comme il n’y avait qu’un Dieu, il n’y avait qu’une « compagnie » et dont lui, Ledormeur, portait pour le moment l’invisible fanion. Le maréchal des logis arrivait avec sa patrouille, deux hommes, de Fort-Polignac, la base de la compagnie. Par Tarat, près de six cents kilomètres. Le chiffre ne dit rien : Paris-Bordeaux, un beau 15. août français, et en six heures.
Mais le chiffre et le thermomètre parlaient au chef de poste de Fort-Saint. Six cents kilomètres : dix jours, dix nuits du déclin du soleil furieux au lever de la lune, de la lune au soleil jailli à boulet rouge. Dix jours et dix nuits à marcher, genoux et semelles gonflés, gorge cuite, à tirer les montures qui encensent et se plaignent, puis à pousser, l’orteil sur l’encolure, à avaler le sable et le feu du vent d’est, les yeux brûlés à sang.
— Tu n’as rien rencontré ? fit une fois encore le chef de poste de Fort-Saint.
— Qu’est-ce que tu veux trouver ? Quelque renard des sables. Tu pourrais le prendre à la main.
— Et la voiture du courrier ?
— Elle doit passer dans dix- huit jours, à Ohanet.
Dans dix-huit jours, une voiture. Voilà sur quoi le voyageur pouvait compter. Et l’égaré de la soif.
Pourquoi cette patrouille, au temps où le nomade lui-même cherche l’ombre ? Le chef de poste de Fort-Saint se gardait bien d’interroger. La frontière brûlait en ce temps-là, et de toute façon, le long du désert libyque. Et les territoires avaient leurs secrets. Une affaire de la compagnie des Ajjer n’était pas une affaire du goum. « Sa mission » remplie sous R’adamès, le maréchal des logis de la Saharienne avait poussé, pour courtoisie, jusqu’à Fort-Saint. Maintenant qu’il avait séché son verre — ni un pernod ni un cinzano, un verre de thé — il se levait pour repartir : service de la compagnie.
— Où sont mes types ?
— Avec les goumiers.
Montures baraquées, les deux hommes de Ledormeur, le Chaambi Embarek et l’Ajjer Khamid, matricules 120 et 451 de la compagnie, étaient accroupis contre le mur de la cour, auprès des goumiers, six ou sept de la garnison de Fort-Saint. Ils avaient fait le thé, attisé une conversation prudente et lente de nomades. Un tel ?... Il avait sa tente à Imoulay... Un de ses cousins était passé... De l’autre côté de la frontière on payait très cher le sucre de contrebande... Mais quant à « la mission » du maréchal des logis, ni Khamid ni Embarek n’en connaissaient rien.
— Ton maréchal des logis t’appelle, dit un goumier à Embarek.
— Il ne sera tout de même pas assez fou pour repartir maintenant ?
Mais Ledormeur écartait déjà la tenture de la porte et leur faisait signe. Il portait le képi bleu ciel de la compagnie bien en place, correct, dévoré seulement par le soleil d’août qui en avait consumé l’étoile. Les deux Sahariens se levèrent. Geste du doigt : repos.
— Nous repartons.
Le maréchal des logis Ledormeur, représentant la compagnie des Ajjer à cette extrême pointe de son parcours, se devait de décoller honorablement sur le front du goum. Il passa donc en revue son détachement, lequel, pour visite et honneurs à un corps étranger, avait revêtu la tenue de parade : gandoura blanche, chèche à chéchia rouge pour Embarek le Chaambi, gandoura bleu noir et chèche sans chéchia, cimier de cheveux, pour Khamid l’Ajjer. Pour les deux, les cartouchières et la ceinture rouge en croix de Saint-André et l’insigne de la compagnie méhariste sur fond de bordj.
Pas de fanion. Il n’y avait qu’un fanion : celui qui reposait, à Polignac, sur ses faisceaux. Pas de clairon. Le maréchal des logis chef de détachement s’enleva sur sa chamelle pie, et mit en route au bras.
Chef de poste, radio et météo regardèrent les trois Sahariens s’éloigner et fondre dans l’éblouissement du grand erg oriental, à la grâce de Dieu, de l’étoile nomade. Alors seulement, le radio de Fort-Saint parla :
— Tout de même, ce sont des durs !
— Oui mon vieux... Et toi qui te croyais le type du sud ! Du sud du sud ! Tu vois ce que tu es ? Moins que rien, une viande à mouches ! Allez viens, je te fais cinq cents points !
C’était vrai. Là-bas, l’homme de chaque bordj, parvenu au prix d’une étape de plus que le camarade laissé au nord, se plaint, s’enorgueillit de son bled comme si celui-ci marquait la fin du monde. Mais la terre française est infinie. Sur ce seuil de Fort-Saint commence encore, dans la suite des suds, après le sud du goum, celui de la compagnie des Ajjer, fanion bleu ciel au croissant étoilé.Même en août, temps de la grande mort, la compagnie tenait donc la frontière. Réveillé par le bruit appétissant du petit verre à thé cassant le sucre, le maréchal des logis Ledormeur, qui mentait à son nom, avait commencé sa journée de bonne heure, à la faveur d’un soleil encore embrumé. Et « sa mission » secrète remplie, il tenait en plein vent, au puits d’Imoulay, son bureau ambulant de permis frontaliers. À pareille saison, les gens qui campent sur ces confins, dans leur éloignement de Fort-Polignac, avaient accoutumé de se dispenser de permis. Mais cet été-là Ledormeur, apparu sous la foudre blanche que l’Européen n’affronte pas, assurait au puits d’Imoulay, limite extrême du ressort de la compagnie, afin que nul n’en ignorât, l’administration ordinaire. Et les gens venaient à ses pieds.
À six cents kilomètres dans le sud, le capitaine commandant la compagnie entrait à cette heure-là dans sa chambre des cartes. Il accrochait au mur son képi aux galons d’or vif, d’une tendresse de pervenche. Et, s’adressant à ses lieutenants :
— J’espère que Ledormeur est sur le chemin du retour !
— En formation de route !
— Bien sûr ! Pointe d’avant-garde. Éclaireurs. Ils sont juste assez !
On riait toujours, à Polignac., des grandeurs de Ledormeur. Mais pour lui, le soleil levant, au puits d’Imoulay, le contemplait dans son royaume. Il avait été une vie où Ledormeur, Jean-Marie-Pierre, vendait du papier à lettres soldé aux éventaires du Bon Marché. Elle ne datait pas de si loin. Les passants, rue de Babylone, l’écrasaient contre son comptoir. L’autobus lui envoyait des giclées de boue. Maintenant, Ledormeur, maréchal des logis à la compagnie des Ajjers, connaissait la majesté d’un Salomon nomade. Les chameliers s’approchaient de sa tente, hachés comme haillons par le vent du matin. Et ils sollicitaient sa bonne grâce, face aux deux, méharistes en armes. Ainsi un garçon de vingt ans était passé dans le règne des dieux.
— Pas celui-ci, Embarek. Pas celui-ci, arrêtait-il de temps à autre. Je vous les couperai, moi vos départs !
Mais un autre destin attendait Jean-Marie-Pierre Ledormeur. Dans les rêves des Sahariens passent encore des chevauchées, d’ardentes chasses de razzieurs. Dans leurs rêves seulement, car le temps des rezzous est maintenant fini, et, depuis des années, nul chef n’a eu la chance d’une poursuite. Or l’ange de l’été voulut que le petit maréchal des logis toujours au garde à vous sous le fanion invisible — un peu cinglé, ce Ledormeur, mais plus dur que la racine sèche — eût à manifester avant de rentrer à la base le suprême pouvoir des couleurs bleu ciel étoilé.
Le bureau en plein vent fermé, Embarek et Khamid venaient de s’étendre pour cuver leur eau magnésienne et, lui-même, le sous-officier allait enfin faire sa sieste lorsqu’un homme accourut, au risque de tomber sous la foudre blanche du ciel d’août. Cinq de ses bêtes, cinq bêtes magnifiques, comme on n’en pouvait voir qu’à Imoulay, avec le pâturage de hadh qui survit aux plus funestes sécheresses, cinq chameaux venaient de disparaître ! Les voleurs ne pouvaient pas être encore loin !
— Assez pleuré, coupa le maréchal des logis, pour arrêter l’homme geignant sa plainte, sous son chapeau de palmes retourné par le vent de feu. Allez, vous autres !
« Embarek et Khamid, debout ! »
Ce n’était plus l’heure de dormir. « Le rezzou » — qu’importait, pour l’imagination et le cœur de Ledormeur, le nombre des pillards — le rezzou faisait déjà route vers la frontière, avec ses prises. Comme aux temps héroïques, lorsque les pelotons des Sahariennes livraient leurs chasses pathétiques, dans l’étendue des deux déserts. Mais Ledormeur, se dirigeant vers sa chamelle, pensait moins à sa gloire qu’au service de la compagnie. Lui présent, même au temps de la grande mort, il ne serait pas dit que la compagnie n’assurait pas, et jusqu’au feu de Dieu, sa police.
Ensommeillés, les deux hommes de la patrouille regardaient le jeune chef déjà dressé sur le ciel blanc.
— Tu attendras au moins que le soleil baisse ! protesta même le taciturne Embarek qui, cependant, treize ans plus tôt, avait fait le contre-rezzou d’Aïn-Cheikh, le dernier de la compagnie.
Mais Ledormeur n’entendait plus. Il avait déplié sa carte :
— Tu dis qu'ils marchent par la dune ?
— Par la dune.
— C’est bien ça. Ils ont crocheté lorsqu’ils ont su que la compagnie était là. Ils piquent carrément au sud. Ils croient nous semer, avec cette chaleur... Allez, en selle ! Tu as l’oreille morte, Khamid ?
Khamid grogna, ravalant une de ses colères rentrées. Le maréchal des logis pensait-il que lui, Khamid, allait crever sa chamelle, une bête née aux jardins de l’Imihrou, partie bien en bosse et déjà fondue, pour cinq carcasses de rosses volées ?
Il fallut cependant boucler le paquetage. Car Ledormeur, tirant sur sa sangle de poil de chèvre, relançait :
— Nous y sommes ?
Embarek et Khamid roulaient encore leurs toiles de tente que déjà leur chef accrochait ses nails à la selle :
— En route !Le vent tombé, le ciel blanc réverbérait une chaleur de brasier intense et mort, à assécher les dernières vapeurs de vie. Ledormeur n’était plus qu’un corps dévoré, passé au feu, réduit à la roche de l’ossature. Ses mains griffues avaient la patine des cuirs. Guéries, les engelures de l’hiver aux éventaires du lundi ! Oublié, le temps des mitaines.
— Tu ne montes pas, Khamid ?... Comme tu voudras.
Préoccupé par sa bête, Khamid l’Ajjer marchait à pied le plus possible. Mais cette fois, c’était de male humeur : on avait bien assez du retour à Polignac par ces journées d'enfer sans aller se crever sur la trace des trois pillards. Que voulaient-ils, ces trois ? Passer tranquillement leurs charognes de l’autre côté de la frontière ? Eh bien, il n’y avait qu’à les laisser. C’était l’opinion de Khamid. Aussi tramait-il, à pied, rêne passée autour de la poitrine, et halant sa chamelle, mousqueton en travers des épaules, crucifié sous la géhenne du ciel blanc.
— Tu ne montes toujours pas, Khamid ? Le maréchal des logis, la nuque encore nue sous le képi blanchi, poussait de l’orteil, prenait de la distance. Sa voix menaçait de mourir. L’Ajjer dut se remettre en selle. Il n’aurait pas fait bon rester seul, dans la fournaise refermée.
— J’ai le ver, grogna-t-il encore, comme s’il avait été lui-même travaillé par le parasite qui commençait à faire éternuer sa chamelle.
— Ça va.
— Ne pousse pas, ne pousse pas, conseillait cependant le silencieux Embarek. Tu ne gagneras pas deux heures.
Ce fut tout juste si Ledormeur céda à la sagesse du vétéran, le temps de faire eau à Timelloulin, le seul puits qui ne distillât pas le poison.
Du plus loin qu’il avait aperçu les trois méharistes, le brigadier indigène commandant le bordj perdu avait monté son fusil-mitrailleur. Car, une fois de plus, l’alarme était sur la « mer », nommée de ce nom assoiffant à cause de ses sources, jaillies de ses touffes de joncs.
— Tu sais les nouvelles ? demanda le brigadier indigène dès qu’il eut reconnu la patrouille. Il y a l’alarme sur la « mer ».
Il y avait constamment l’alarme sur la « mer ».
— Moi, je suis en contre-rezzou, dit Ledormeur.
Et, le plein fait, guerbas encore ruisselantes, il passa la porte du bordj, laissant le brigadier indigène cloué de stupeur sous son mirador. Contre-rezzou ? À perte de vue, vers la nécropole des carrières d’où les hommes, à la saison qui permet la vie, avaient tiré la pierre, l’étendue flambait, dissipant en fumée les trois silhouettes évanouies.
Khamid renonça enfin à marcher à pied. Le ciel fondait jusqu’aux humeurs. La chamelle du guide ajjer, naseau foré par le ver, toussait, le fatigant de ses saccades. Or, il y avait assez à faire pour avancer, tenir, obéir à l’impulsion sourde, acharnée du chef :
— Plus vite. Nous les avons !
Or, le trace ne semblait même pas fraîchir. Sans doute, les deux groupes perdus, truqueurs et traqués, allaient-ils de la même allure, à la limite de la vie.
— Le soleil t’aura à la nuque, avertissait Embarek le Chaambi, morne et tout encapuchonné sous son chapeau de palmes.
Ledormeur consentit à envelopper son képi de son chèche. Par trois fois déjà, le fourmillement noir l’avait sonné.
La chasse continua. La chasse ? Hommes et bêtes se traînaient dans les méandres de la mort torride, la convulsion d’un astre consumé. De loin en loin, Khamid se laissait glisser à terre. Et, versant quelques gouttes d’eau dans l’écuelle décrochée de sa selle, il donnait à boire à son chef et à son compagnon, tandis que sa bête toussait.
— Nous les avons, Khamid, promettait le maréchal des logis.
La trace des pillards, de leurs prises, et celle de leurs campements, inquiets, écourtés, se faisait plus récente. Après les nuits, les jours, le moment ne pouvait plus tarder où le « rezzou » serait rejoint ou tenterait un changement de route, afin de ne pas approcher davantage des parages vivants de Fort-Polignac. Mais déjà Khamid et Embarek avaient passé le seuil. Fièvre de la razzia ? La mort d’août l’avait tuée.De fait, un jour, la trace tourna, quittant à angle droit la direction nord-sud, qui était celle du Fort, pour se jeter vers le soleil levant.
— Les salauds ! jura Ledormeur. Le soleil sanglant du matin bondissait au-dessus du banc de brume qui condense pour la journée les puissances du feu. Le maréchal des logis se tourna vers lui comme vers une lampe amie, et, dépliant sa carte, il chercha :
— Voyons, Bourarhat doit bien être par là !...
Que cherchait-il ? Le terme de la mort ? Le moment était-il venu de prendre la chamelle pie à la rêne et d’arrêter l’égaré ?
— Bourarhat doit être par ici, cherchait l’enfant, le même garçon qui, il n’y avait pas si longtemps, les jours de l’été vide de Paris, guettait le marchand de glaces devant son éventaire du Bon Marché.
Le puits de Bourarhat figurait, en effet sur la carte, aussi bien que la Fontaine de Vaucluse sur une carte Michelin. Il se situait sur une belle tache bistre qui, elle-même, portait en capitales le nom d’Erg d’Edeven. Mais, à l’œil, il n’y avait, dans la direction du soleil aveuglant, que les meurtrissures de traces.
— C’est bien ça... Ils cherchent le puits de Bourarhat et puis le trou de la Frontière... Tu le connais, le puits de Bourarhat, Khamid ?
Khamid était passé au puits de Bourarhat. Mais on était à la saison où nul ne peut dire qu’il ne mourra pas faute d’avoir trouvé l’eau.
— Si tu ne le trouves pas, si tu tournes un jour, seulement un jour...
Se jeter vers Bourarhat, c’était abandonner la dernière ligne de vie, se vouer, avec des bêtes exténuées, au hasard d’un angle de route, d’un repère déformé par les hallucinations de midi ou de la tempête de sable surgie des sarabandes des démons et qui enfouit et perd la source du salut. Et Khamid dérobait, ne se souvenait plus.
— 451, tu es trop jeune à la compagnie, Khamid ! fit le chef, appelant à dessein l’homme par son matricule. Tu ne la connais pas. Jusqu’à Bourarhat et jusqu’au feu du diable, la compagnie garde la frontière. En août, comme en décembre. Il ferait bon voir !
Embarek, le vieil Embarek, renâclait, lui aussi . Il ne voulait pas aller, laisser sa peau sur la piste de Bourarhat.
C’est bien, le Français irait seul. Dans l'espace blanc où il avançait, nulle voix ne le soutenait plus. Embarek et Khamid, pourtant, marchaient à son ombre. Mais le désespoir les cernait. Un jour, un jour encore, et s’ils ne trouvaient pas le puits, ils commenceraient à tourner en cercle, comme les agonisants du Grand Erg. Seul le chef, soutenu par l’absurde orgueil qui l’habitait, portait le groupe. Puisque rien n’apparaissait plus, que seul Dieu pouvait être juge, ne fallait-il pas que, sur cette étendue, tout se passât comme si le fanion bleu ciel de la compagnie avait flotté sur chaque dune ?
Ledormeur pensait-il encore aux pillards, dont la trace, elle aussi, avait tourné, en proie au vertige, et cherchait sous le ciel la pitié de l’eau ? L’heure approchait où le corps ne nourrirait même plus la volonté.
Emmenés, Embarek et Khamid suivaient. Dans une dernière quinte de toux, la chamelle de l’Ajjer avait enfin jeté le ver qui lui rongeait, depuis Ohanet, le naseau. Et, l’ayant écrasé sous sa semelle, elle allait, dans le halètement de la soif. Après la dune, une autre dune, un autre changement de route :
— Eux aussi, ils se sont perdus.
Le puits de Bourarhat, pour les fuyards, pour les chasseurs, où était-il ? Où avait- il, dans les tourbillons, les fumées, enfoui ses abords battus, son eau sourde ?
Les fuyards devaient souffrir la même transe. À moins qu’ils n’eussent jamais existé, comme le murmurait Khamid, et que leur trace désorientée, zigzaguant de dune en dune, ne fût qu’un piège des démons pour le châtiment des profanateurs de la mort d’août.
Le dernier jour, les trois chasseurs crurent voir des formes humaines à la crête du cif qui les séparait de la nuit. Mais chacun se méfiant des hallucinations de l’autre, ils ne s’interrogèrent pas.
— Dieu seul le sait ! Cette fois le sous-officier se tut, se sentant désormais trop près des apparitions qui donnent tort. Ledormeur, au matin, n’en fut que plus fort pour secouer Khamid :
— Alors, tu n’y vois plus ? Qu’est-ce que c’est que ce guide ? Tu ne les vois pas ? Compagnie, à mon commandement !
Dans ce paysage d’autre monde, la crise de grandeur pouvait se pardonner. D’ailleurs, le rapport du maréchal des logis Ledormeur ne fait pas mousser, même d’un doigt, l’histoire. Mais bien des pelotons et des groupes nomades coururent le désert pour moins et y trouvèrent leurs gloires.
Pur combat saharien. En arrière du puits — une écorchure grise — les bêtes du butin. En avant, couvrant l’eau qu’ils n’avaient peut-être pas puisée — le vent avait roulé ses dunes toute la nuit — les « razzieurs » embusqués.
— Je les vois bien, je les vois bien ! grogna Khamid, la joue sur la crosse.
— À mon commandement...
— Attends, ils font signe...
— À coups de fusil, oui !
Deux ou trois balles avaient miaule.
— Alors, feu !
Salve de trois.
Son combat terminé. Ledormeur s’avança lui-même vers le puits livré par les vaincus. Le premier, cadavre de la soif, avait été retué par les balles. Un seul vivait encore et se plaignait.
Pourtant, sur le campement du repos, la nuit d’après, Jean-Marie-Pierre Ledormeur crut garder les morts d’un grand baroud.
— Vous allez dormir tous les deux. Je veillerai, avait-il dit.
Lorsque les trois nomades, ayant désensablé le puits jusqu’à la nuit, eurent roulé d’épuisement, seul debout, seul vivant face à la frontière, Ledormeur s’adossa à sa selle, mousqueton appuyé à la croix.
Service de la compagnie. La nuit d’août tressaillait, soumise. Et le maréchal des logis, dans sa nuit d’orgueil, avait le sentiment de garder, de tenir à lui seul, sous le fanion bleu ciel au croissant étoilé, de Fort-Saint aux monts de Toummo, les mille kilomètres de frontière de l’Empire.
Ce temps n’est pas si loin. Au puits de Bourarhat, ce soir encore, à la lune d’hiver, une autre patrouille nomadise. Un autre chef, deux autres hommes, sous le même fanion. Un autre Ledormeur, comme lui venu de la vie morne et admis à la royauté du nomade.
Joseph PEYRÉ.